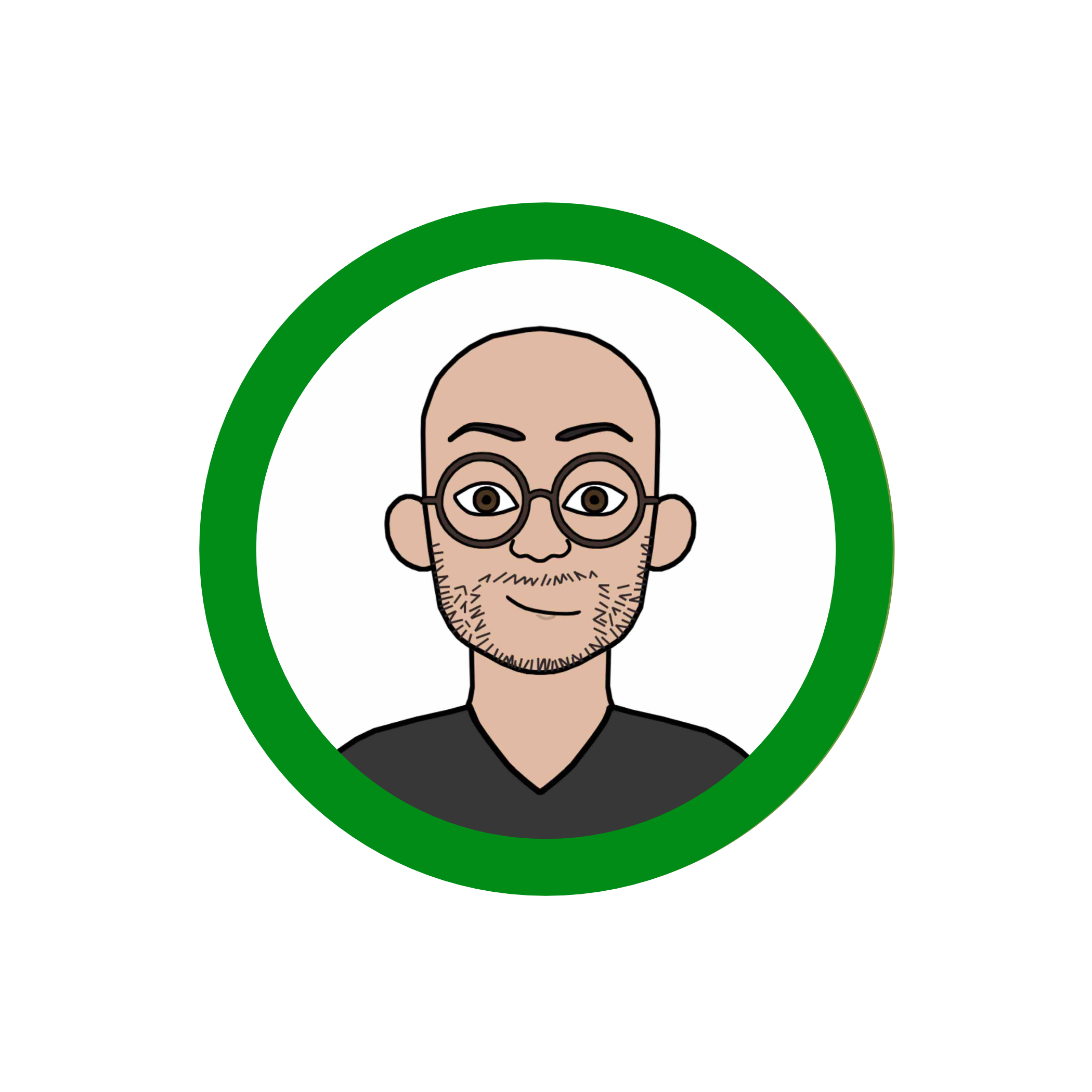Conseils lecture
« Ça va pas la tête ou quoi ? » est un album jeunesse au ton très humoristique, écrit par un habitué du genre qui en devient, album après album, le spécialiste de « l'humour pour les petit·es ».
Seulement pour les enfants ? Bien sûr que non ! Il arrive toujours à surprendre ses lecteur·rices quel que soit leur âge. Ici encore, il parvient à nous amuser avec trois fois rien : des yeux, un nez, une bouche et des formes multiples.
Cela fonctionne à merveille jusqu’au final, une chute savamment orchestrée.
Cet album est drôle, coloré, rythmé… et surtout plein d’intelligence. À lire, relire et partager sans modération !
2151 : l’humanité vit dans 7 mégalopoles tandis que la nature reprend ses droits sur le reste de la planète. La surexploitation des ressources de la Terre au début du 21e siècle et les désordres qui s’ensuivirent ont décimé la population. Le seul et dernier espoir des hommes pour un monde meilleur : la conquête spatiale. La plupart en rêvent, Youri non, car sa mère, Simone, prépare son départ pour une mission spatiale sans retour, SOON. Le scénario échafaudé par Thomas Cadène et Benjamin Adam est fouillé et confère à cette bande dessinée une intensité qui se révèle petit à petit. Dans ce récit d’anticipation, il est bien évidemment question d’écologie et de l’urgence à changer nos habitudes de consommation. Mais il nous interroge aussi et surtout sur ce qui nous fait aller de l’avant, partir à l’aventure, donner du sens à nos actions et à nos vies. Ce qui fait d’un simple citoyen un bon fils, un homme amoureux, un père attentif, ou d’une mère une femme aimante et conquérante. Le graphisme créé par Benjamin Adam est sublime et participe de cette profondeur. Il alterne illustrations en bichromies sur fond noir pour relater la conquête spatiale et sur fond blanc pour narrer l’histoire de Youri. Ainsi, il donne corps à cette dualité, être et devenir, qui oriente chacun de nos gestes et crée le monde de demain. « Soon » est un beau récit d’anticipation à la fois sombre et lumineux qui fera de vous un lecteur comblé. - Michaël
Trois frères et une sœur très viscéralement soudés vivent dans cette vallée perdue. Ils travaillent comme tous les autres habitants, en totale dépendance de la centrale électrique et du barrage. Le créateur de ce barrage, homme mystérieux et violent règne en tyran. Ses hommes de main font régner la peur et la soumission. Cette tragédie moderne nous questionne sur nos compromissions et sur l'effet de groupe face à une société refusant de remettre en cause ses principes. Mais il y aura toujours des insoumis. Ces courageux grains de sable, qui choisissent le risque plutôt que la peur. Dommage que Bouysse ne développe pas davantage. Malgré une fin écourtée, quel plaisir de lecture ! Une écriture puissante, parfois poétique, somptueuse et vraiment bien maîtrisée. - Catherine
Il y a quelques années, dans un pays voisin, un homme qui aimait les carrés plus que tout prit le pouvoir par la force. Ce jour là, les rectangles, les ronds, les triangles, tous ceux qui n’étaient pas carrés, disparurent. Le pays sombra alors dans le malheur, jusqu’à ce qu’enfin… Ximo Abadia, talentueux auteur espagnol, nous raconte une histoire qui n’est certes pas la nôtre, mais dont le message est universel : celle de la liberté. Vous l’aurez compris, cet album parle, sans le nommer, du militaire Franco qui imposa de 1936 à 1975 un régime dictatorial en Espagne et fit de nombreuses victimes. Bien évidemment, l’auteur utilise l’art de la métaphore, de la parabole pour en livrer une version simplifiée mais efficace. Il dénonce ce drame, mais avertit également que le monde est fragile et qu’il peut vite, si l’on n’ y prend pas garde, sombrer facilement dans l’obscurantisme.
Ximo Abadia est un artiste à l’œuvre unique et reconnaissable entre toutes. Illustrateur graphiste, il joue avec les couleurs, les formes et les matières, rendant un ensemble étrange, mais cohérent, dynamique et époustouflant.
« Le Dictateur » est une œuvre de mémoire nécessaire et dont le positionnement est rare en littérature jeunesse.
Quand on a déjà navigué on sait qu'il y a quelque chose d'intime qui se joue sur l'océan, quelque chose d'intime et de vrai, sur la mer on est face à soi, sans faux semblant, on ne triche pas et on ne ment pas. Quand on a déjà navigué on sait que cette sincérité est le prix à payer pour que l’océan nous tolère. On sait que pour lui survivre il ne faut pas le contrarier. On sait que tout est fragile et sensible sur la mer, qu’on marche sur un fil, en équilibre sur la ligne d'horizon.
Tout cela l’héroïne du livre, commandante au long court, le sait. Elle sait que la routine est la condition sine qua none pour se maintenir en osmose avec les éléments. Elle le sait et pourtant elle va ouvrir une brèche dans l’ordinaire et basculer dans un univers parallèle, une parenthèse dont vous sortirez transformés.
Un livre plein de mystère, une écriture délicate et sensible qui vous berce comme le sac et le ressac de l’océan et vous emporte vers une destination inconnue. Un subtil mélange de suspense et de poésie, un roman indispensable.
Pour les amoureux·ses de l’océan et de sa petite musique, je vous conseille aussi « Novecento : pianiste » d’Alessandro Barrico, également disponible à la médiathèque.
Une série de meurtres effroyables affole la ville de Gotham. Pour résoudre cette affaire, le meilleur détective du monde, Batman, est appelé en renfort. Cependant, cette enquête va le mener dans une machination sans pareil où le tueur sanguinaire ne serait que la porte d’entrée d’une affaire bien plus sordide…
Batman Dark Party est une saga en quatre volumes qui présente, dans chacun des albums, un récit policier complet. Les auteurs, via cette série, renouent avec le Batman de la fin des années 30, qui, bien avant d’être un super-héros se battant contre des menaces cosmiques, était avant tout un personnage élucidant moult affaires par sa réflexion et ses qualités de détective.
Dans cet album, une atmosphère sombre et inquiétante est de suite installée, elle transpire l’angoisse. Batman est présent, mais pas son alter ego Bruce Wayne, ce qui laisse entièrement la place à l’enquête, dont le mystère tient en haleine jusqu’à la dernière page. Nous suivons notre héros, bien plus humain, bien plus fragile, un parti pris des auteurs pour le rendre accessible. Les illustrations et les cadrages d’Hayden Sherman dénotent également de la production régulière. Il apporte un dynamisme et une fraîcheur rarement atteints ces dernières années.
Avec "Batman Dark Party", les auteurs signent une œuvre dense et captivante, qui rend hommage aux racines les plus sombres du Chevalier Noir. Ce premier volume donne le ton d’une saga prometteuse, où l’enquête prime sur l’action, et où Batman redevient ce qu’il est fondamentalement : un détective traquant les ombres.
Depuis une certaine soirée, Mélinda est devenue une paria dans son lycée. Jour après jour elle subit les brimades de ses camarades et l’aveuglement de ses professeurs. Ses seuls moments de paix se passent dans un local d’entretien désaffecté où elle s’est créé un nid douillet et a érigé en dieu protectrice « Maya Angelou », artiste et militante américaine pour les droits civiques. Lorsqu’elle rentre au domicile familial, elle ne trouve pas non plus le soutien dont elle a besoin. Restant dans un certain mutisme, ses parents ne lui reprochent que ses faibles résultats scolaires et son manque de travail, sans réellement voir sa détresse. Pourtant, loin de faire une crise d’adolescence, Mélinda cache un drame, une histoire dont elle ne peut parler, mais qui la ronge à petit feu... Adapté du roman éponyme, l’histoire de Mélinda ne nous laisse pas indifférent. Elle traite d’un sujet grave et difficile : le viol. L’action se situe quelques semaines après le crime et dépeint le quotidien de la victime, enfermée dans son mutisme par peur, par honte. Nous assistons à sa chute vertigineuse dans les abysses du cauchemar, à sa coupure avec le monde. Si le récit nous parait si juste c’est qu’il raconte la véritable histoire de l’auteure, Laurie Halse Anderson, violée à l’âge 13 ans, mais qui a réussi à surmonter cette horreur. Elle nous livre donc ici un témoignage puissant, mais loin d’être dans le mélodrame, il donne une leçon de force et de courage. Il dépeint le quotidien de ces victimes d’actes odieux, mais nous livre aussi un message d’espoir, de reconstruction. « Speak » est une œuvre salutaire, à prescrire tant il est source de compréhension et de force. Alors, grand merci Madame Laurie Halse Anderson, pour toutes ces femmes que vous rendrez libres. - Michaël
Le lieutenant Yamada n’est plus vraiment l’homme qu’il était. Après la mort accidentelle de sa fille et le départ de sa femme, il est devenu un personnage bien terne, mais comment lui en vouloir ?! Après une descente dans une maison close maquillée en salon de massage, il rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille. Cette rencontre va le bouleverser et il n’aura de cesse dès lors de venir en aide à cette jeune désemparée... Keigo Shinzo, par le biais de la fiction, nous dépeint un pan peu reluisant de la société japonaise : celui de la prostitution estudiantine. Ces jeunes filles, fugueuses et/ou sans un sou, pour survivre ou continuer leurs études, sont abusées par des hommes peu scrupuleux. Problème social alarmant, le « JK business » (JK pour Joshi Kosei qui se traduit par lycéennes japonaises) attire malheureusement beaucoup de filles qui, dans l’idée de se faire beaucoup d’argent en peu de temps, tombent rapidement dans la prostitution, aux griffes de la mafia et mettent leur vie en danger. L’auteur alimente également le récit par un autre élément dramatique, celui du deuil et de l’absence. Chaque personnage incarne une forme de désespoir, d’appel au secours, qui, s’il est crié par l’un·e est entendu·e par l’autre. On ne tombe pas dans le misérabilisme, certainement pas, mais plutôt dans une forme d’espoir en la nature humaine. Car, ce qui ressort le plus, à la lecture de cette bande dessinée, c’est avant tout la bonté et l’amour. Les illustrations, en noir et blanc, sont classiques, mais l’auteur nous gratifie par moment de gros plans extrêmement expressifs des visages de nos personnages, changeant ainsi le rythme de l’histoire et accentuant aussi son aspect dramatique. « Mauvaise herbe » est un titre sociétal à l’aspect rude, mais profondément humain. - Michaël
C’est l’heure de manger chez la famille Rat. Papa a préparé des pommes de terre.
Un vrai délice pour les enfants, mais ils sont cinq et il y a 6 pommes de terre…
Qui aura la chance de la manger en plus… Un véritable casse-tête pour papa Rat.
Simple, mais efficace, cet album pour les tout-petits est un délice.
Les illustrations à la « Disney » sont tout simplement très belles, et les rats trognons à souhait. L’auteur utilise une palette de couleurs réduite : de l'orange, du bleu et leurs nuances. Le tout est rehaussé par une touche de blanc.
Guillaume Bracquemond a également travaillé sur la mise en scène, des plans tantôt larges, tantôt moyens, donnant ainsi beaucoup de rythme à l’histoire.
L’auteur aborde, de façon humoristique, la notion de partage, mais aussi, au détour, la place du papa moderne.
Un album rat’fraîchissant.
Ils sont trois : Canard, Cochon et Lapin. Ils vont accepter, par la force des choses, la mission de livrer un bébé humain à sa famille… Mais, n’est pas cigogne qui veut et nos trois compères, tous plus maladroits les uns que les autres, vont vivre une incroyable aventure… « Un bébé à livrer » est la première bande dessinée de Benjamin Renner, rendu célèbre par son titre « Le Grand méchant renard » adapté au cinéma. Ce titre est une pure merveille d’humour et de mise en scène rythmée. L’auteur excelle dans l’écriture de situations absurdes, jamais méchantes, mais toujours tordantes. Nous suivons les personnages dans leur périple et rions à chaque page, aidé par un dessin expressif et nerveux. Par son écriture, il réussit la prouesse de s’adresser aux enfants et aux adultes. Seul petit bémol, le mal aux zygomatiques que nous procure la lecture de cet ouvrage, mais il parait que cela est bon contre les rides… - Michaël
Cette bande dessinée biographique traite d'une figure emblématique de l'agriculture écologique : Akinori Kimura. Pas vraiment destiné à devenir agriculteur, Akinori, par les aléas de la vie, va devoir reprendre l'exploitation fruitière de son père. Étonné par le nombre de pesticides à utiliser pour faire de belles pommes, il va dévouer sa vie à trouver des solutions naturelles pour exploiter son verger... quitte à ruiner sa famille. Totale réussite que ce titre japonais sur une personnalité internationale de l'agriculture naturelle et raisonnée, peu connue en France. Il nous entraîne dans le Japon rural des années 50, sous le joug des traditions et de la productivité à tout prix. Pourtant, seul contre tous, un homme va oser proposer une alternative. Captivant et historique ! - Michaël
Conseils lecture
Lorsque les parents se séparent, il n’est pas toujours facile pour un enfant de trouver sa place, surtout quand on a deux maisons pour deux nouvelles vies… Melanie Walsh, par cet album tendre et réfléchi, décrit simplement, en quelques mots, la vie des enfants de parents séparés. Les thèmes habituels de la douleur ou de l’absence sont volontairement absents de ce récit qui se concentre sur des aspects plus « prosaïques », mais pas moins importants.
Du coup, ce titre n’est pas plombant, au contraire, il est même positif et rassurant pour l’enfant. Par un système de rabats-surprises, l’autrice joue à nous faire découvrir la vie chez l’un, puis chez l’autre, sans jamais donner un jugement de valeur. Elle conclut son histoire avec douceur et laisse entrevoir la multitude de facettes que peut prendre l’amour familial. « Chez papa et chez maman » est un album incontournable sur la thématique de la séparation qui ne l’expliquera pas, mais qui saura rassurer nos enfants sur le quotidien, leur avenir et l'amour que leur portent leurs parents. Et c’est bien cela le plus important. - Michaël
Voici un merveilleux petit roman d’anticipation, réconfortant et bienveillant qui, une fois n’est pas coutume, envisage positivement l’avenir de l’humanité, tout en évitant l’écueil du récit mièvre et sirupeux, dégoulinant de bons sentiments.
Sur Panga dans un avenir lointain les êtres humains vivent en respectant leur environnement. Ils ont développé grand nombre de stratégies et de techniques leur permettant de réduire au minimum leur impact sur la planète. Ici tout est beauté et harmonie et on se laisse, alors, gentiment bercer par l’idée que oui c’est possible ! Et ça fait un bien fou !
Mais tout n’est pas si simple, Dex, moine pourtant émérite, n’est pas réellement convaincu par la vie qu’il mène. Il se lance alors dans une quête existentialiste qui va le pousser à explorer la nature sauvage tout en sondant sa nature profonde. C’est au détour d’une clairière qu’une rencontre inattendue lui permettra de mettre en perspective son rôle et la place de l’humanité dans le monde.
Un texte à la fois doux, drôle et profond, une grande réussite !
A noter : bien qu’il s’agisse du volume 1 de la nouvelle série de l’autrice Becky Chambers, ce récit aurait tout à fait pu se suffire à lui-même, son dénouement n’appelant pas forcement une suite.
En ces temps de fête et de post-confinement, envie de se (re)faire une beauté ? Eh bien lisez cet album destiné aux plus petits et qui présente un ours polaire jardinier maniant la cisaille comme un pro. Sa tâche du jour le conduit dans sa belle auto orange jusqu'au parc municipal... Grâce à une intrigue narrative originale et à un humour décalé, les enfants comme les parents se reconnaîtront dans les personnages que croise notre ours bonhomme. Les illustrations sont expressives, colorées d'aplats de couleurs restreintes à quelques nuances.
« En beauté ! » est un bel album, tout en simplicité, mais au charme indéniable. Et en plus, c'est une création de l'un de vos bibliothécaires préférés...
Svitlana et Dmyrto forment un couple d’étoiles, amoureux à la ville comme à la scène. Le 23 février 2022 au soir, ils dansent Le Lac des cygnes avec le ballet de Kiev. Le lendemain, l’Opéra national, comme toute l’Ukraine, est happé par la guerre.
Dès lors, le couple s’investit dans le combat pour défendre leur patrie, leurs valeurs, mais aussi leur culture. L’art, et surtout la danse, seront leurs armes de résistance, notamment pour Svitlana, alors que Dmyrto partira au front.
Malgré certaines rivalités au sein du corps de ballet en temps de paix, c’est la solidarité qui rejaillira face à l’adversité.
Stéphanie Pérez s’inspire de la véritable troupe du ballet de Kiev qui, en signe de résistance, fit une tournée européenne au début de la guerre. Ayant passé deux ans au cœur du conflit en tant que grande reporter, elle nous entraîne au plus près du réel, nous faisant ressentir la peur, la mort omniprésente, les alertes, et le besoin de sauver sa peau.
Que faire quand soudain la guerre éclate ? Quitter son pays, s'engager pour lutter contre l'ennemi, attendre la mort ? Ce sont ces interrogations poignantes auxquelles l’autrice nous invite à réfléchir.
Un récit bouleversant, qui nous permet de mettre des noms et des visages sur ce peuple ukrainien si proche, et à la fois si lointain.
Dans la forêt de Bois-joli, ce soir c’est le réveillon de Noël. Mr Ours est confortablement installé dans sa tanière douillette, décorée pour l’occasion. Il neige depuis dix jours. Mr Ours a utilisé tout son bois et n’a plus de feu dans sa cheminée. En cherchant dans son grenier, il trouve un gros pull appartenant à sa grand-mère. Parfait ! il va avoir bien chaud ! En essayant le pull, il s’aperçoit que celui-ci est trop grand. Pas de souci, Mr Ours sort son nécessaire à couture et ajuste le pull à sa taille. Comme il reste de la laine, il décide de la donner à sa voisine Mme Blaireau. Celle-ci, ravie, se confectionne des guêtres. Avec la laine restante, à son tour Mme Blaireau se rend chez sa voisine Mme Hérisson…
C’est ainsi que de fil en aiguille, la laine se passe de voisin en voisin jusqu’au plus fragile habitant du Bois-joli, créant une jolie chaîne d’entraide.
Armelle Modéré écrit un très joli conte de Noël, doux comme un gros pull. Qui parle d’amitié, de partage, de solidarité. Une petite notion d’écologie puisque la laine du pull va servir à tous.
Les jeunes enfants apprécieront les animaux sympathiques et les illustrations joyeuses et colorées de ce bel album.
L’alternance entre images vives pleine page et dessins sur fond blanc avec en fil conducteur le brin de laine rose fluo donne le rythme à l’histoire.
La collection ‘’Père castor’’ reste une valeur sûre de la littérature jeunesse.
Ada Müller vit seule avec son père depuis que sa mère les a quittés. Son quotidien à la campagne est dur en cette année 1917, l’hiver s’annonce rude et son père la maltraite, lui impose de nombreux travaux physiques harassants. Ses seules distractions sont sa chienne Gertha, mais également la peinture qu’elle pratique en cachette et qui fait l’objet d’un échange épistolaire avec E(gon). Elle profite d’un déplacement de son père à Vienne pour montrer ses derniers travaux à son correspondant, loin du regard paternel, du moins le pense-t-elle.
Barbara Baldi, qui s’était déjà fait remarquer avec « La Partition de Flintham », récidive en créant un beau personnage d’artiste féminine dont la vocation contrariée ne peut s’éteindre. Son histoire, à la fois terrible et touchante, bénéficie d’un dénouement inattendu. Il faut souligner la patte de l’auteure, la beauté de ses cases peintes, y compris lorsqu’elle reprend certains portraits iconiques de la peinture moderne. Barbara Baldi creuse son sillon dans la bande dessinée, l’écrivant de façon très romanesque et féminine. Cette œuvre vous séduira d’abord par son esthétique picturale avant de vous conquérir définitivement par son histoire, singulière. - Michaël
"La Petite Bonne" est au service de plusieurs familles bourgeoises en région parisienne, notamment celle des Daniel, un couple atypique. Blaise, ancien pianiste, est une gueule cassée, invalide et mutilé de la Première Guerre mondiale. Son épouse, Alexandrine, lui consacre tout son temps avec une dévotion sans faille.
Sur l’insistance de son mari, Alexandrine décide de s’accorder une escapade à la campagne et confie Blaise aux soins de "La Petite Bonne" pour trois jours. Livrée à elle-même avec le maître des lieux, la jeune domestique va devoir s’improviser aide-soignante. Peu à peu, à mesure que les confidences se nouent, les apparences se fissurent et les rôles s’inversent.
La mise en page singulière, alternant narration, vers libres et prose, donne une voix unique aux trois protagonistes. Avec une grande sensibilité, Bérénice Pichat aborde des thèmes profonds tels que la souffrance, la mort et le fossé entre les classes sociales.
Ce huis clos haletant et bouleversant nous happe dès les premières pages. L’autrice permet à ses personnages d’exprimer leurs pensées les plus secrètes, les plus inavouables. J’ai été particulièrement touché·e par le face-à-face poignant entre ces deux êtres cabossés par la vie, que tout semblait opposer.
"La Petite Bonne" est un roman intimiste et original, tant dans sa forme que dans son propos, mêlant suspense, tension, rebondissements et émotion, jusqu’à une fin totalement inattendue.
Chloé Berthoul, est une femme de 38 ans qui vit dans la ville moyenne de Gabarny avec son compagnon Greg, sa belle-fille Colette et leur fils Raoul. Deux fois par semaine, elle fréquente les réunions du « Belles Mères Anonymes ».
Le quotidien tranquille de Chloé est bouleversé lorsque ses voisins apparemment sans histoires sont impliqués dans une affaire de braquage et lorsqu’un secret de famille éclate. Prenant conscience de la banalité de son quotidien, Chloé se lance dans une quête pour retrouver un trésor disparu avec l'aide de Lapouta, un enfant de son immeuble, qu’elle prend sous son aile.
« Une époque en or » aborde avec humour et une écriture percutante des thèmes sociaux actuels comme les familles recomposées, les violences conjugales, le machisme et le réchauffement climatique. Le ton reste léger et accessible malgré la gravité des sujets traités.
Comment un gladiateur devait-il s'équiper pour affronter les bêtes sauvages dans l'arène ? Que signifiait la crête sur le casque d'un légionnaire ? Pourquoi les Romains avaient-ils un si fort attachement au dieu de la guerre, Mars ?
Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en grand format, sous la forme d'une collection d'objets rares et étonnants.
Avec une attention particulière portée aux détails, chaque trésor est fidèlement représenté, accompagné de quelques anecdotes incroyables. Une fiche descriptive présente le lieu où l’objet a été découvert, ainsi que son lieu d’exposition actuel.
Découvrez ce livre fourni d’informations claires et intéressantes., mêlant archéologie, mythologie, et art. Vous voyagerez à travers la Rome antique grâce aux magnifiques illustrations présentes tout au long de la lecture.
Lily et ses parents viennent de déménager au bout du monde, dans les montagnes, pour se rapprocher de mamie. « Cette nouvelle maison avait une odeur étrange et était toute vide… » La petite fille se sent seule. Lors d’une balade pour découvrir les environs, elle trouve un bébé licorne perdu et coincé dans les ronces. La fillette décide de ramener le petit animal chez elle. Avec l’aide précieuse de sa grand-mère, qui semble bien connaître les licornes, Lily va prendre soin de sa nouvelle amie au fil des saisons…
Briony Mary Smith entraîne les lecteur·ices dans un univers merveilleux. Les illustrations sont superbes dans des tons naturels aux nuances de terre, verts, bruns, gris…qui évoquent les grandes étendues. Le côté champêtre se retrouve également sur les vêtements aux motifs campagnards des personnages. Le blanc est utilisé pour la licorne.
On est touché par le lien qui unit l’enfant et la créature, et par la maturité de l’héroïne qui comprend qu’il faudra bien la laisser un jour retrouver sa famille. Quand le moment de la séparation arrive, Lily, malgré sa tristesse, va aller de l’avant, passer à autre chose et se faire de nouvelles amies tout en gardant dans son cœur les moments vécus avec le petit animal.
Cet album ne ressemble pas aux autres livres de licornes. C’est une belle histoire d’amitié enfantine pleine de magie, d’imaginaire et de douceur.
Depuis toujours les chat·tes fascinent, félins sauvages, indépendant·es mais également câlin·es et tendres à leurs heures. Avec ce très bel album on découvre ou redécouvre 11 poèmes ou extraits de la littérature, passant par Baudelaire, La Fontaine ou bien encore Lewis Caroll. Les textes sont aussi variés que leurs auteurs. Face à ces écrits onze illustrateur·rices contemporain·es proposent dans leurs différents styles un portrait se mariant avec l’écrit.
Cette magnifique galerie d’images et de mots ravira bien sûr les amoureux·ses des matous et charmera aussi sans nul doute les autres.
« Petits portraits de chats » est un ouvrage inclassable. C’est à la fois un album, sans histoire, que l’on peut lire au gré de ses envies et au hasard des pages, un livre d’art que l’on regarde pour ses magnifiques illustrations, ou bien encore un recueil de poèmes.
J’ai beaucoup aimé la multiplicité des styles de ce livre, qui met à l’honneur avec malice et modernité, la poésie, genre souvent oublié.
Un très bon moment de lecture cocooning.
Julian voyage dans le métro avec sa Mamita quand soudain il voit passer trois magnifiques femmes habillées en sirène. Admiratif, il rêve alors lui aussi d’en devenir une. Arrivé chez sa Mamita, il entreprend de se confectionner un magnifique costume avec les rideaux et plantes d’intérieur, et Mamita le surprends ! Que va-t-elle penser de lui ? Elle pense qu’il est temps de l’amener à la grande parade des sirènes. Jessica Love nous offre un magnifique récit ancré dans la modernité et dans les questionnements actuels de la société. Julian, un petit garçon, qui rêve de s’habiller en sirène ? et pas d’adultes pour lui dire qu’il n’a pas le droit de le faire ? cela fait du bien ! Le message d’amour et de tolérance de la Mamita pour son petit-fils est touchant de tendresse. Les illustrations prennent vie sous nos yeux. Les postures et gestes des personnages sont magnifiquement illustrées et la vie d’un quartier afro-américain mis en scène avec humour, fourmillant de petits détails. Entre ces scènes de la vie quotidienne se glissent des pages plus oniriques, ou Julian donne libre cours à son imagination du monde aquatique. Cet album est un régal tant dans la justesse du récit que dans le thème abordé ; les illustrations elles, nous vont droit au cœur. Il est assurément, l’un de mes plus grands coups de cœur de cette année 2020.
Lorsqu’elle se réveille, Hilda n’est plus chez elle, ni vraiment elle-même. Elle est dans une grotte, chez les monstrueux Trolls. Pourtant, elle n’est pas en danger. Son corps s’est transformé, elle est devenue l’une de ces créatures effrayantes et passe totalement inaperçue. Que s’est-il passé ? Quelle est la raison de sa présence ici ? Et si l’occasion lui était donnée d’apprendre à connaître un peu mieux ce peuple dont on ignore tout ? Sixième et à priori dernier volume de la série Hilda, et comme dans les précédents tomes, on se régale à la lecture de ses aventures. Comme toujours, Luke Pearson nous plonge dans un univers étrange, mais toujours teinté de bienveillance. Cela est la force de ses récits, nul ne sait comment il y arrive, mais ouvrir un Hilda est une expérience à part. Peut-être cela est-il dû à un délicat mélange d’humour, de fantaisie, de fantastique et peut-être de mélancolie, mais toujours est-il que ses histoires, et celle-là encore plus, sont captivantes. Nous assistons à la fin d’une série, ou peut-être, espérons-le, simplement d’un cycle. Un clap de fin qui met en exergue la différence, la tolérance et la force de l’amitié. Tant de messages à transmettre à nos enfants, tant de messages dont on peu s’inspirer pour nous ouvrir aux autres. Les illustrations sont toujours aussi belles, même si depuis 2011 le trait de l’artiste anglais à quelque peu évolué, je vous encourage vivement à reprendre le premier tome. La gamme de couleurs pastels employée ajoute une atmosphère de douceur, de calme, de bien-être. « Hilda » est sans conteste l’une des meilleurs séries jeunesse de ces dix dernières années, alors partagez-là. Pour info, Hilda existe également en série animée sur la plateforme « Netflix ». - Michaël
Depuis une certaine soirée, Mélinda est devenue une paria dans son lycée. Jour après jour elle subit les brimades de ses camarades et l’aveuglement de ses professeurs. Ses seuls moments de paix se passent dans un local d’entretien désaffecté où elle s’est créé un nid douillet et a érigé en dieu protectrice « Maya Angelou », artiste et militante américaine pour les droits civiques. Lorsqu’elle rentre au domicile familial, elle ne trouve pas non plus le soutien dont elle a besoin. Restant dans un certain mutisme, ses parents ne lui reprochent que ses faibles résultats scolaires et son manque de travail, sans réellement voir sa détresse. Pourtant, loin de faire une crise d’adolescence, Mélinda cache un drame, une histoire dont elle ne peut parler, mais qui la ronge à petit feu... Adapté du roman éponyme, l’histoire de Mélinda ne nous laisse pas indifférent. Elle traite d’un sujet grave et difficile : le viol. L’action se situe quelques semaines après le crime et dépeint le quotidien de la victime, enfermée dans son mutisme par peur, par honte. Nous assistons à sa chute vertigineuse dans les abysses du cauchemar, à sa coupure avec le monde. Si le récit nous parait si juste c’est qu’il raconte la véritable histoire de l’auteure, Laurie Halse Anderson, violée à l’âge 13 ans, mais qui a réussi à surmonter cette horreur. Elle nous livre donc ici un témoignage puissant, mais loin d’être dans le mélodrame, il donne une leçon de force et de courage. Il dépeint le quotidien de ces victimes d’actes odieux, mais nous livre aussi un message d’espoir, de reconstruction. « Speak » est une œuvre salutaire, à prescrire tant il est source de compréhension et de force. Alors, grand merci Madame Laurie Halse Anderson, pour toutes ces femmes que vous rendrez libres. - Michaël
Goliath n’est pas comme les autres enfants, il est grand, très grand, voir très très grand et cela le peine. Il est différent…
Ximo Abadía, auteur espagnol dont j’admire l’œuvre propose avec cet album un récit touchant empli de sagesse et de beaucoup de tendresse. Il évoque le thème de la différence, du mal être et de comment trouver sa place dans la société. Loin d’être triste, le récit se transforme en quête initiatique dont chaque scène est une impressionnante rencontre. En cela son travail graphique est remarquable, il juxtapose les formes, les matières pour rendre des tableaux d’une extrême efficacité. Très peu de couleurs sont utilisées, les mêmes page après page, savamment dosées et distillées afin d’offrir différentes ambiances, différentes émotions à l’histoire.
Goliath est un géant et heureusement pour nous, son amour aussi alors, il serait dommage de s’en priver !
« Vole, vole, Carole ! » est l’histoire d’une martin-pêcheur qui, un beau jour, se décide, malgré les réticences de son frère et de sa sœur, à quitter le nid, à s’envoler.
Hélas pour elle, la chute sera vertigineuse…
Voici un très bel album qui aborde avec finesse les thèmes de l’apprentissage, de la prise d’indépendance et du courage.
À travers des dessins expressifs, réalisés à l’aquarelle et au crayonné, rehaussés de douces couleurs, l’auteur nous embarque, page après page, dans une plongée rocambolesque aux multiples rebondissements.
Pour accentuer l'effet de la chute, l'album doit être tourné de 90 degrés vers la droite avant de commencer le récit. De cette manière, on tourne les pages vers le haut, tandis que la jeune Carole tombe vers le bas.
Une très belle réussite et un excellent moment de lecture avec cette histoire touchante et pleine d’humour, qui ravira les enfants, mais aussi les parents, heureux de partager un pur moment de complicité.